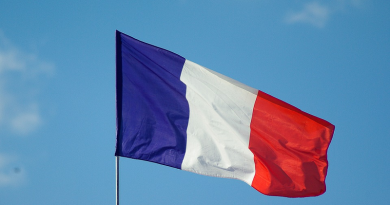Ukraine : l’hypothèse d’un partage gelé du territoire refait surface
Alors que le conflit s’enlise, un émissaire américain relance l’idée d’une partition de l’Ukraine inspirée du modèle berlinois de l’après-guerre. Une suggestion provocante, qui reflète un changement de ton dans certaines sphères occidentales.
Une guerre figée dans l’impasse
Plus de deux ans après le déclenchement de l’invasion russe, la guerre en Ukraine semble avoir atteint un point de stagnation stratégique. Ni Kiev ni Moscou ne parviennent à reprendre un avantage décisif sur le terrain. Les lignes de front, particulièrement figées dans le Donbass, évoquent désormais les conflits de position du siècle passé. Dans ce contexte d’usure, l’hypothèse d’un statu quo territorial prend de l’épaisseur dans certains cercles diplomatiques occidentaux.
C’est dans ce cadre que Charles Kupchan, ancien conseiller de Barack Obama et aujourd’hui émissaire officieux des États-Unis, a évoqué publiquement un scénario de « séparation » de l’Ukraine, sur le modèle de l’Allemagne divisée après 1945. Lors d’une interview sur CNN, il a suggéré que l’Occident pourrait devoir accepter une « Ukraine amputée » dans l’attente d’un règlement de paix global. Si cette idée ne constitue pas la position officielle de Washington, elle traduit une inflexion rhétorique marquante dans le débat américain sur l’issue du conflit.
L’évocation d’un parallèle avec Berlin Est et Berlin Ouest, divisés pendant près d’un demi-siècle, n’est pas neutre. Elle installe l’idée que l’unification territoriale de l’Ukraine pourrait ne plus être une priorité réaliste, au profit d’une stabilité géopolitique minimale. Une idée jugée inacceptable par les autorités ukrainiennes, pour qui toute concession territoriale équivaudrait à une victoire stratégique de la Russie et un précédent dangereux pour l’ordre international.
Un tournant dans les postures occidentales ?
Cette déclaration intervient dans un climat de fatigue stratégique chez les alliés de l’Ukraine. Aux États-Unis, le Congrès peine à voter de nouvelles aides militaires, tandis que l’Europe reste divisée sur l’ampleur de son soutien. Le président américain Joe Biden, en campagne pour sa réélection, compose avec une opinion publique de plus en plus sceptique face à un engagement de long terme.
Dans ce contexte, les propos de Kupchan résonnent comme un ballon d’essai. Ils testent l’acceptabilité d’un changement de doctrine : passer d’un soutien inconditionnel à la reconquête ukrainienne à une logique de containment du conflit. Cette approche, inspirée de la Guerre froide, permettrait de stabiliser les fronts, tout en maintenant une pression diplomatique et économique sur la Russie.
Pour les Européens, ce virage possible est porteur d’ambiguïtés. S’ils souhaitent éviter une escalade régionale, une paix bancale consacrant l’occupation de territoires par la force est difficilement compatible avec les principes défendus par l’Union européenne. Emmanuel Macron, qui s’est récemment montré plus offensif dans son soutien à Kiev, a d’ailleurs écarté toute hypothèse de « partition consentie », affirmant que « la paix ne peut se faire sur le dos de l’Ukraine ».
Une paix gelée ou une paix impossible ?
L’idée d’un partage du territoire ukrainien ravive aussi des clivages anciens. Pour Kiev, il ne peut y avoir de compromis sur l’intégrité nationale. Le président Volodymyr Zelensky a rappelé que tout plan impliquant l’abandon de la Crimée ou du Donbass serait « une trahison de la souveraineté et des morts de la guerre ». L’Ukraine, soutenue par plusieurs pays baltes et nordiques, refuse un scénario à la coréenne qui figerait durablement l’occupation russe.
Du côté russe, l’intérêt pour un gel du conflit dépend largement de la situation militaire et intérieure. Vladimir Poutine pourrait y voir une opportunité de consolider ses gains territoriaux, sans reconnaître explicitement une frontière nouvelle. Mais tout compromis supposerait des garanties sur la non-intégration de l’Ukraine à l’OTAN – un point de discorde majeur.
L’idée d’une séparation à la berlinoise révèle en creux la difficulté occidentale à envisager une victoire ukrainienne totale, tout en refusant la capitulation morale que représenterait un abandon de territoire. Elle incarne une forme de réalisme stratégique désenchanté, qui contraste avec les déclarations lyriques du début du conflit.
En définitive, l’hypothèse avancée par Charles Kupchan n’est pas encore une doctrine, mais elle traduit un état d’esprit : celui d’un conflit que l’on ne sait plus résoudre, mais que l’on souhaite au moins contenir. À défaut de paix, la tentation d’un gel ordonné des lignes devient une option pensable, sinon souhaitable. Mais l’Histoire a souvent montré qu’un cessez-le-feu sans règlement politique durable n’était qu’un prélude à la guerre suivante.